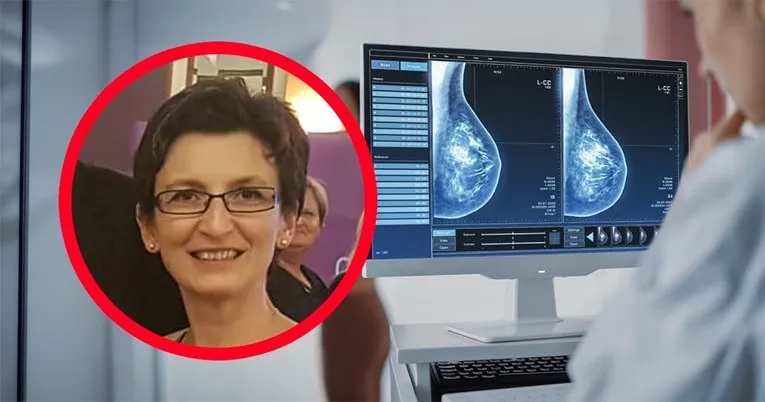Une virologue croate, atteinte d’un cancer du sein en phase avancée, a défié les traitements conventionnels. Refusant la chimiothérapie, elle s’est soignée elle-même en utilisant des virus oncolytiques cultivés en laboratoire. Quatre ans plus tard, elle est en rémission totale. Une prouesse qui intrigue la communauté scientifique.
 Le parcours singulier d’une chercheuse déterminée
Le parcours singulier d’une chercheuse déterminée
En 2020, Beata Halassy, virologue de renom à l’Université de Zagreb, apprend que son cancer du sein est revenu pour la deuxième fois, à l’endroit même où elle avait subi une mastectomie. À 49 ans, elle se retrouve face à un dilemme : suivre une nouvelle série de chimiothérapies éprouvantes, ou explorer une voie inexplorée mais prometteuse – celle de la virothérapie oncolytique.
Après avoir étudié en profondeur la littérature scientifique internationale, elle décide de s’auto-administrer un traitement expérimental, basé sur deux virus soigneusement sélectionnés :
-
Le virus de la rougeole, déjà testé dans des essais cliniques pour certains cancers.
-
Le virus de la stomatite vésiculaire (VSV), connu pour cibler spécifiquement les cellules tumorales.
 Qu’est-ce que la virothérapie oncolytique (OVT) ?
Qu’est-ce que la virothérapie oncolytique (OVT) ?
La virothérapie oncolytique consiste à utiliser des virus naturels ou génétiquement modifiés pour infecter, détruire les cellules cancéreuses, et stimuler une réponse immunitaire contre la tumeur. Contrairement à la chimiothérapie qui affecte l’ensemble des cellules, y compris saines, l’OVT agit de manière plus ciblée.
Déjà utilisée aux États-Unis sous forme de T-VEC (virus de l’herpès modifié) pour traiter le mélanome métastatique, cette approche reste marginale dans la plupart des pays, notamment pour les cancers du sein, en l’absence d’approbation officielle.
 Une auto-expérimentation réussie… mais controversée
Une auto-expérimentation réussie… mais controversée
Contre toute attente, l’état de santé de Beata s’est amélioré de manière spectaculaire. Quatre ans après son traitement, elle est toujours en rémission complète, sans avoir eu recours à la chimiothérapie ni à la radiothérapie.
Mais cette auto-expérimentation a suscité des réactions vives dans la communauté médicale. Si certains saluent son courage et sa rigueur scientifique, d’autres dénoncent un manque d’éthique, et craignent que des patients abandonnent les traitements éprouvés au profit de méthodes non validées.
Jacob Sherkow, chercheur en droit médical à l’Université de l’Illinois, souligne :
« Le problème n’est pas qu’elle ait expérimenté sur elle-même, mais qu’elle publie ses résultats de manière publique, ce qui peut encourager des patients désespérés à se détourner de la médecine fondée sur les preuves. »
 Vers un avenir vétérinaire… et peut-être humain
Vers un avenir vétérinaire… et peut-être humain
Forte de son expérience, Beata Halassy a obtenu un financement pour explorer l’usage de l’OVT chez les animaux domestiques atteints de cancer, une première étape vers une validation scientifique de son approche. Elle explique que cette expérience personnelle a transformé l’orientation de son laboratoire :
« Mon objectif désormais est de démontrer scientifiquement que cette méthode peut avoir une réelle efficacité, d’abord chez les animaux, puis chez l’humain. »
 Le cancer, une menace croissante
Le cancer, une menace croissante
Selon Santé publique France, 433 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2023, dont 57 % chez les hommes. Le cancer reste la seconde cause de mortalité dans le monde, selon l’OMS, derrière les maladies cardiovasculaires. Dans ce contexte, toute avancée, même marginale, peut représenter un espoir immense pour des millions de patients.
 Une histoire qui interroge et inspire
Une histoire qui interroge et inspire
Le cas de Beata Halassy pose la question suivante : les chercheurs ont-ils le droit de devenir leurs propres cobayes ? Son histoire soulève des enjeux cruciaux :
-
Les limites de l’expérimentation individuelle ;
-
La nécessité de valider scientifiquement les innovations thérapeutiques ;
-
Et le besoin de nouvelles approches dans la lutte contre le cancer, qui touchera selon les prévisions 1 personne sur 2 au cours de sa vie.

L’histoire de Beata Halassy est peut-être le début d’un changement de paradigme.